LIBREVILLE, 10 octobre 2025 (AGP) – À l’occasion de la Journée mondiale de l’architecture, célébrée le 7 octobre dernier sous le thème «Concevoir la résilience», Hermès Allogho-Eko Mba, président du Conseil national de l’Ordre Gabonais des Architectes (OGA), revient sur les enjeux de la profession et les défis de l’aménagement urbain du Grand Libreville. L’entretien s’inscrit dans le cadre de la semaine de sensibilisation et de consultations gratuites organisée du 7 au 10 octobre 2025. Lecture.
AGP : Quel est, selon vous, le rôle fondamental de l’architecte dans la société gabonaise contemporaine ?
Hermes Allogho-Eko Mba : “L’architecte a un rôle fondamental dans chaque société. Il apporte des solutions dans la création d’espaces de vie en prenant en compte les facteurs environnants, qui révèlent des aspects créatifs, d’aménagement, de conception et de durabilité, pour offrir aux populations un cadre de vie viable et harmonieux”.
Quelles sont les missions prioritaires de l’Ordre des Architectes du Gabon, notamment en matière de régulation, de formation et de valorisation du métier ?
“Cet Ordre est créé par un décret, qui le place sous la tutelle du Ministère des Travaux publics et de la Construction. Il est mis en place pour s’assurer d’encadrer et de coordonner les activités et l’exercice de la profession en République gabonaise. C’est notre mission principale.
Chaque architecte est diplômé d’une école d’architecture, où il a effectué un stage d’au moins deux à trois ans dans un cabinet d’architecture, que ce soit sur le plan local ou à l’extérieur. Après cette étape, il est inscrit au tableau de l’Ordre lorsqu’il se sent intéressé. Faute d’écoles d’architecture au Gabon, les Gabonais sont formés à l’école sous-régionale dénommée École Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) de Lomé (Togo), dont notre pays est membre depuis sa création en 1975. Toutefois, nous invitons nos membres à saisir les opportunités pour la mise à jour de leurs connaissances, car notre métier évolue avec l’existence de nouveaux matériaux de construction plus respectueux de l’environnement et du climat. D’où la nécessité de se recycler pour répondre aux besoins du moment”.
Comment vos travaux ont-ils contribué à façonner l’identité architecturale de Libreville et à répondre aux enjeux urbains actuels ?
“Au Gabon, tous les projets montés pour Libreville sont réalisés, pour la plupart, par des architectes gabonais. On peut citer l’immeuble Orgavie, les infrastructures sportives. Pour traduire l’identité dans un projet architectural, il revient donc à la ville de demander aux acteurs que nous sommes, de la construction, de nous donner la possibilité de pouvoir lui rendre l’identité qu’elle souhaiterait avoir. Et cela constitue notre rôle et notre travail. Nous avons besoin que, dans la commande publique ou privée, des gens puissent apprécier la matérialisation culturelle de notre pays, de nos valeurs, de nos sens même aiguisés, et qui nous permettent de le représenter soit dans la forme, soit dans le profil, soit dans la vue, soit dans l’aménagement des projets que nous réalisons. En gros, lorsque la commande est encadrée et que la réalisation se fait dans les règles (commande, études, réalisation et réception des travaux), les bâtiments réalisés par les architectes façonnent l’image de la ville”.
Comment intégrer la notion de résilience dans l’aménagement du Grand Libreville, face aux défis climatiques, démographiques et infrastructurels ?
“Plusieurs paramètres sont à prendre en compte lorsqu’on parle de résilience, d’où ce thème choisi cette année par l’Union Internationale des Architectes : «Concevoir la résilience». Il faudrait qu’aujourd’hui le bâtiment, le cadre de vie, l’espace de vie soient capables de résister à tous les facteurs environnants. Il peut y avoir de l’agressivité sur le plan climatique, physique, voire sur plusieurs paramètres, mais nos conceptions doivent tenir dans le temps et la durée.
Il faut dire que, dans notre pays, l’incivisme ou la nécessité de s’installer, ou l’absence de programmes d’aménagement, de programmes de construction, de logements sociaux, poussent parfois la population qui densifie les villes à s’installer dans des espaces libres, qui ne sont pas constructibles pour la plupart. Dans le cadre de la nature des sols, il est important, lorsqu’on veut réaliser un projet, de faire d’abord une étude géotechnique. Ce sont des études préalables qui permettent souvent de définir un ensemble de paramètres pour réaliser un projet. Il faut savoir que l’on peut habiter dans l’eau, dans les sols meubles. Mais il faut d’abord des études préalables, qui doivent emmener le technicien à déterminer la nature et la typologie des fondations qui vont être réalisées.
Nous n’avons pas l’habitude de faire ce genre d’études-là lorsqu’on est dans l’autoconstruction. Il y en a qui vont même jusqu’à construire des immeubles sans avoir fait des études de sol, de prospective et de dimensionnement des fondations, qui permettent d’avoir un bâtiment ou de proposer un bâtiment stable dans l’espace dans lequel il est positionné”.
Propos recueillis par CM/CBM/FSS/AGP












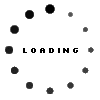

Commentaires